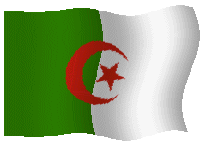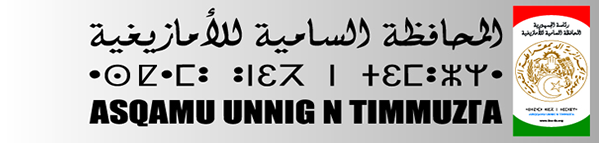El Moudjahid - Colloque international : du 20 au 22 août à Annaba «Jugurtha affronte Rome»

Le Haut Commissariat à l’Amazighité organise, du 20 au 22 août 2016 au Théâtre Azzedine-Medjoubi d’Annaba, en collaboration avec le ministère de la Culture, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et la contribution de la wilaya d’Annaba, un colloque intitulé «Jugurtha affronte Rome». En attendant le déroulement de cette rencontre historique et scientifique, brève évocation de celui qui, en plus d’avoir été roi de Numidie, fut le premier grand résistant et inventeur de la guérilla contre un impérialisme donné -l’impérialisme romain- que l’histoire de l’humanité ait connu. On ne saurait que peu de choses sur les anciens royaumes berbères d’Afrique du Nord, si le Bellum Iugurthinum (La guerre de Jugurtha) ne nous était pas parvenu. Salluste, l’auteur de l’ouvrage, qui fut nommé gouverneur de l’«Africa Nova» (l’Afrique nouvelle) par César, un demi-siècle après les événements qu’il décrit, connaissait bien le pays et nous a rapporté des faits précis. Outre le récit de cette «guerre contre Jugurtha», il nous donne un aperçu, avant la conquête romaine, de la géographie et de l’histoire ancienne de ces royaumes de Numidie et de Maurétanie. Cette géographie historique, largement modelée ensuite par les travaux des spécialistes français du 19e siècle, a été influencée, notamment, par les idées dominantes de l’époque. Cette vision historique a provoqué et provoque encore, à travers les résistances culturelles dans ces pays, des réactions contre les schémas simplificateurs des «bienfaits» de la civilisation romaine, ou contre l’héritage des frontières coloniales. Elle reste encore un élément non négligeable de l’actuelle géopolitique de cette Afrique du Nord.
Le «Muluccha», oued frontière incertain
Concernant les limites anciennes de ces royaumes berbères, Salluste est formel : l’oued Muluccha servait de frontière entre les royaumes de Jugurtha et de Bocchus 1er. Il précise même que Jugurtha, lors du partage de la Numidie à la mort de Micipsa, hérite de la partie qui jouxte la Maurétanie. D’après les travaux menés par André Berthier et l’équipe du CNES-Archéologues tunisiens, travaux attestant que la fameuse «Table de Jugurtha» à Kalaat-Senane, en Tunisie, est bien celle décrite dans les écrits de Salluste, le problème de cet oued frontière Muluccha a fait couler beaucoup d’encre chez les historiens. Il a été l’objet de bien des controverses, rarement de recherches prospectives et jamais de recherches archéologiques. Toujours est-il que les historiens doivent à Stéphane Gsell la première synthèse de cette histoire ancienne de l’Afrique du Nord. Son œuvre monumentale, qui date de 1927, est encore influente. S. Gsell pensait reconnaître dans le Muluccha de Salluste, l’oued côtier algéro-marocain Moulouya, rejetant ainsi les propositions d’autres auteurs : le Mellègue algéo-tunisien ou l’oued Sahel. En particulier, il pensait que la Moulouya portait le double nom de Muluccha et de Malva. En réalité, le nom de Malva s’applique toujours à la Moulouya algéro-marocaine. En revanche, Pomponius Méla et Pline l’Ancien appliquent le nom de Muluccha à un fleuve distinct de la Moulouya et coulant plus à l’Est. Quant à Strabon, il parle de Molochath comme limite des Maures et des Masaesyles. Mais S. Gsell conclut que la source utilisée par Pomponius Mela et Pline était erronée et admet que l’antique Maurétanie s’étendait sur l’actuel royaume chérifien, tandis que la Numidie couvrait la majeure partie de la Tunisie et la totalité de l’Algérie tellienne. Évidemment, des doutes furent émis par d’autres chercheurs, l’historien Syme, pour sa part, estimait qu’il n’y a qu’un cas sur trois pour que le Muluccha de Salluste ne soit pas la Moulouya située si loin à l’Ouest. Mais ces réserves sont restées sans suite véritable.
Le «Castellum» de Salluste (Table de Jugurtha)
Revenons à Salluste qui nous apporte sur cet oued Muluccha une précision importante. Voici ce qu’il écrit dans son Bellum Iugurthinum : «Non loin du fleuve Muluccha, qui séparait les royaumes de Bocchus et de Jugurtha, il y avait, tranchant sur le reste de la plaine, une montagne rocheuse d’une hauteur immense, assez étendue pour porter un fortin...». Il consacre pas moins de quatre chapitres au siège de cette forteresse avec de nombreux éléments descriptifs -apport incomparable- pour déterminer ce site. S. Gsell reconnaissait pourtant que cette forteresse (sur les rives de la Moulouya) est «fort éloignée des lieux où les Romains avaient combattu et hiverné jusqu’alors», mais il concluait à l’impossibilité de retrouver son emplacement sous prétexte qu’il y a en Afrique beaucoup de tables rocheuses qui répondent à cette description. L’argument n’est certainement pas convaincant, puisque l’historien Ernest Mercier a tenté de la retrouver et a proposé pour cette «montagne immense» de Salluste, un mamelon situé près de l’oued Sahel (Kabylie). L’autre historien, Jérôme Carcopino, conscient de l’importance stratégique de cette position, crut reconnaître dans le poste marocain de Taourirt la citadelle numide, mais il juge sa solution assez «aventureuse». Taourirt est en effet très éloigné du champ habituel des opérations des Romains et se trouve à plus de 1.500 km à l’ouest de Gafsa, ville que Marius venait d’enlever précédemment. Une telle opération n’a pas de sens stratégique et paraît matériellement impossible, même si on suppose une année de campagne de Marius dont Salluste ne dit pas un mot : il n’y a pas de rupture dans son texte entre la prise de Gafsa et l’arrivée près de l’oued Muluccha. Au contraire, l’auteur évoque la connaissance «des malheurs de Capsa» par les habitants des villes enlevées au passage par Marius. Il serait difficile d’admettre pour l’époque que les habitants de ces villes, algériennes dans ce cas, soient informés d’événements se déroulant dans le lointain sud tunisien.
«Un sentier fort étroit et bordé de précipices»
Cette expédition lointaine marocaine est par ailleurs une «vraie énigme» pour Syme, «d’où une double difficulté pour le Muluccha (Moulouya) avec ni nom, ni indication pour expliquer comment Marius atteignit cette région reculée, et nulle mention de quartier d’hiver entre 107 et 106 av. J.-C.». Ainsi, cette chevauchée lointaine de Marius à travers une «Algérie en rébellion» pour aller prendre cette place forte au Maroc et revenir ensuite sur ses pas paraissait bien étrange en vérité. Pourtant, dans un ouvrage paru à Constantine en 1950, André Berthier et ses collaborateurs avaient proposé une solution qui levait ces ambiguïtés. Pour eux, le Muluccha est l’oued Mellègue qui fait frontière entre l’Algérie et la Tunisie et la forteresse, un plateau tabulaire, la Kalaat-Senane en Tunisie. Si cette thèse a parfois ébranlé certains historiens, elle était rejetée par de nombreux autres auteurs, par exemple Tiffou, Julien, etc. Pour tenter de réconcilier deux thèses si contradictoires, une investigation archéologique sur le terrain était souhaitable à Kalaat-Senam en Tunisie, mais aussi à Taourirt au Maroc. Ce qui fait dire à l’historien Tiffou que le Muluccha «restera hypothétique, tant qu’on n’aura pas repéré avec certitude l’éminence rocheuse peinte assez précisément par Salluste». Au lieu de cela, le texte de Salluste continue d’être discuté et «certains conçoivent le grave soupçon que l’historien soit victime d’erreur ou de confusion». Le jugement de S. Gsell -à savoir «nous ne tenterons pas, d’après les données de Salluste, de retrouver l’emplacement de ces sites»-, a influencé à décourager, peut-être, de nouvelles recherches sur le problème. À noter que trois missions franco-tunisiennes se sont rendues à Kalaat-Senane pour y effectuer des investigations, puisque aucune recherche n’avait été conduite jusque-là. Cette montagne tabulaire domine par sa masse et par son altitude (1.271 m) les Hautes Terres environnantes de près de 600 m, et ses falaises calcaires surmontent de plus de 100 mètres un immense cône d’éboulis. Cette mésa quasi ovale couvre une superficie de 80 ha. «Assez étendue pour porter un fortin, auquel on n’accédait que par un sentier étroit» dit Salluste. Les vestiges d’une menaa, occupée par les Berbères jusqu’en 1910, en couvrent environ 4 ha, auxquels on n’accède que par «un sentier fort étroit et bordé de précipices». Les investigations en question ont ainsi été engagées en Tunisie en rapport avec le Bellum Iugurthinum. Les travaux, conduits sur le terrain par trois missions franco-tunisiennes avec l’aide de la section archéologie du CNES, apportent des éléments nouveaux sur la géographie de l’ancienne Numidie. Les éléments matériels apportés ici permettent d’identifier la Table de Jugurtha avec le «Castellum», si minutieusement décrit par Salluste. Cette proposition que les brigades topographiques avaient faite en leur temps et reprise par A. Berthier(*) et ses collaborateurs, n’a trouvé que peu de partisans. Ceci est surprenant puisque les opinions contraires n’offrent, en regard de cette Table de Jugurtha, aucun site digne de reconnaissance archéologique et ne s’appuient pas sur des réalités ethno-géographiques. À la lumière de ces travaux, il faut convenir, pour tout dire, que le fleuve Muluccha-Mellègue n’est plus hypothétique, mais bien une réalité historique tangible, avérée.
(*) André Berthier, auteur, entre autres, de La Numidie, Rome et le Maghreb, Éditions Picard, Paris 1981, a été conservateur du Musée national Cirta de Constantine jusqu’en 1971. Kamel Bouslama El Moudjahid du mardi 16 août 2016