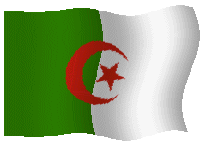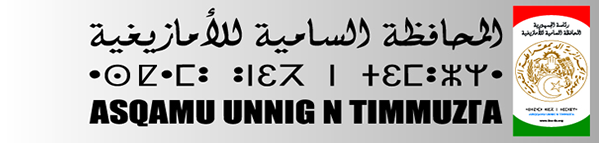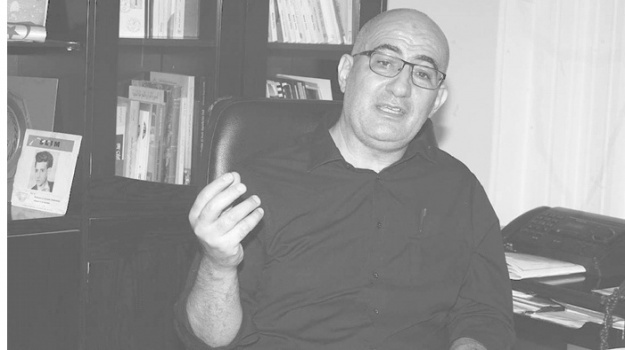Le Soir - Professeur Mhammed Hassine Fantar : notre arabité irrigue notre amazighité
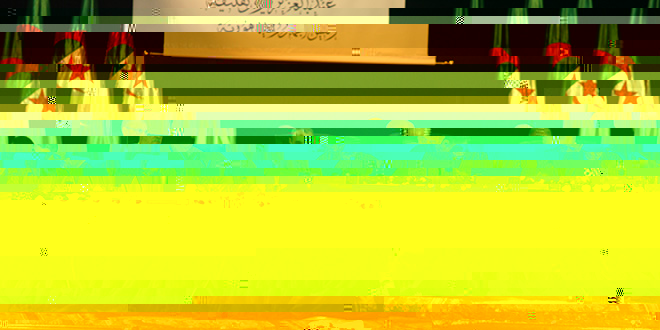
Message du Professeur Mhamed Hassine Fantar au Secrétaire Général du HCA, Mr Si El Hachemi Assad. 
Il m'a fait honneur et plaisir de partager les trois riches journées de Bône consacrées à Jugurtha affrontant Rome dont l'impérialisme était alors exclusif. Nous avons vécu de très riches heures dans une ambiance où fuse la jeunesse venue de partout pour apprendre à être. Vous avez su discrètement créer cette ambiance où les adultes sont venus offrir leur expérience pour qu'elle soit au service de tous. A Bône, j'ai retrouvé des amis qui ont la vertu de rester jeunes malgré les années. Avec Jugurtha, vous nous avez ouvert la voie de la jeunesse et du combat.
Congratulations et Merci pour tout. Avec mes cordiales salutations. Mhamed Hassine Fantar. Professeur émérite aux universités Site web : www.mhamed-hassine-fantar.com* * * * * *
Entretien avec Mhammed Hassine Fantar,
Professeur émérite,
expert en histoire ancienne.
Il est des personnalités impossibles à circonscrire dans un cadre, une notoriété parce que notre invité, professeur émérite, échappe à la description du portrait classique d’homme de lettres et de sciences tant son parcours est parsemé de distinctions, haut en couleur, dirions-nous. Mhammed Hassine Fantar, car c’est de lui dont il s’agit, a été «prophète» dans son pays, la Tunisie, pour acquérir par la suite une reconnaissance internationale - Europe, Méditerranée, monde arabe. Spécialiste de la civilisation phénicienne punique et des antiquités libyques (berbères) il l’est aussi pour les langues ouest sémitiques du Proche-Orient. Il a occupé à plusieurs reprises la fonction de directeur dans les domaines qui relèvent de ses compétences. Il s’est vu décerner le titre de docteur honoris causa (Bologne et de l’université de Sassari, Italie), et de celui d’officier de l’ordre du Mérite culturel de France, etc. Le Haut Commissariat à l’Amazighité (HCA) a été bien inspiré de le convier au colloque international, tenu récemment dans la ville de Annaba, sur le thème «Jugurtha affronte Rome» aux côtés d’autres historiens de l’Algérie antique, c’est-à-dire la Numidie au temps de la montée en puissance de l’Empire romain. Du haut de ses 80 ans, ce gentleman, affable et prévenant par son écoute, pertinent par ses remarques et suggestions et dérangeant aussi par ses prises de position, donne, sous nos yeux, une leçon de sérieux par son assiduité dans toutes les séances du colloque. Nous ne pouvions faire l’impasse sur l’opportunité qui nous était offerte de nous rapprocher de lui afin de lui soumettre quelques questions pour les lecteurs du Soir d’Algérie. Son attitude amène nous a encouragé donc à happer un peu de sa disponibilité. Il nous répond à la façon propre aux hommes du savoir, réfléchie et directe. A noter aussi que notre invité est auteur d’un livre sur Jugurtha, écrit lorsqu’il était étudiant.
Le Soir d’Algérie : Peut-on connaître votre sentiment sur ce colloque et quelles étaient vos attentes en rapport avec cette réunion de spécialistes de l’Antiquité de cette région du Maghreb ?
Mhammed Hassine Fantar : Je suis très content d’avoir eu cette chance de participer à ce colloque sur Jugurtha. En fait mes relations avec Jugurtha remontent au temps de mes études universitaires à Strasbourg. Une fois mes études terminées, mon premier livre, écrit en langue arabe, que je lui ai consacré, a eu un grand succès en Tunisie. Au fond, j’ai constaté que Jugurtha est un personnage séduisant, il plaît, y compris à ceux qui n’ont pas étudié l’histoire ancienne. Moi-même quand j’en parle c’est avec enthousiasme car c’est un personnage qui symbolise la résistance à l’agresseur. Mais c’est aussi un personnage complexe, très ouvert, cultivé et qui parlait au moins quatre langues en plus de sa langue maternelle, le punique et certainement le grec car son grand-père avait beaucoup de relations avec les Grecs et puis aussi le latin. C’était une personne d’envergure internationale, polyglotte ayant acquis une solide formation. De par son physique, il a séduit Scipion l’Africain et sûrement aussi la jeunesse romaine dorée de l’époque d’où cette publicité énorme qu’il a eue parmi les Romains qui l’ont adopté.
Les débats ont tenté de proposer de dépasser les idées de Salluste quant à son livre le Bellum Lugurthinum. Est-ce possible sachant qu’il en constitue l’unique source et que tous les communicants admettent par ailleurs ?
La position de Salluste a été ambiguë. Lui aussi a été certainement séduit par la personnalité de Jugurtha dont il a aussi dit du bien, il a reconnu sa beauté, son intelligence, son savoir-faire. Ce n’est pourtant pas sur Jugurtha qu’il a écrit son livre mais il s’est plutôt servi de lui pour parler des vices de la société romaine à laquelle il appartient. Il l’a écrit une fois à la retraite dans un sentiment d’échec de sa carrière politique, Jules César son protecteur étant parti. Finalement le livre de Salluste ressemble à une pièce de théâtre avec tous les éléments de mise en scène. Il dénonce les vices des aristocrates, pour dire que la vertu est désormais aux côtés de Marius, les démocrates en quelque sorte.
Il faut rendre à César ce qui appartient à César, autrement dit à Salluste ce qu’il lui revient car sans lui on n’aurait jamais rien su sur l’Histoire du roi numide ?
Salluste, c’est certainement une chance pour nous Africains car on peut lire beaucoup de choses entre les lignes. C’est aussi un tableau sur l’Afrique dans la description des villes et la situation du royaume.
On relèvera que, dans ce colloque, si l’on a beaucoup focalisé sur la personne de Jugurtha et ses démêlés avec Rome, presque rien n’a été dit sur la société dans laquelle il vivait, les forces qui le soutenaient, la vie culturelle et artistique ? Pourquoi cet oubli ? Une omission involontaire sans doute ?
Il ne faut pas oublier que Jugurtha a hérité d’un royaume créé presque de toutes pièces par Massinissa qui était amoureux de Carthage. D’ailleurs il devait épouser Sophonisbe, mais c’est Carthage qui l’a trahi et non l’inverse. Il faut voir que là aussi Carthage a été victime de la noblesse qui ne pensait qu’au profit aux dépens même des villes qui dépendaient de Carthage.
Professeur, vous êtes un grand spécialiste des Phéniciens. Que reste-t-il de leur civilisation ?
Ce qu’il faut retenir c’est que Carthage a été la première République dans le monde. Quand elle était une grande métropole, Athènes était encore un petit village. La première Constitution dans le monde fut celle de Carthage. Aristote en a fait l’éloge et il la trouve supérieure aux Constitutions d’autres villes grecques et en avance dans la Méditerranée orientale. Seulement elle a été minée par ceux qui ne recherchaient que le profit. Tonybet disait quelque chose d’extraordinaire en affirmant que le plus grand ennemi de l’homme est le profit. Carthage diffusait richesses matérielles et immatérielles en Sicile, Sardaigne, l’Italie du Sud jouant donc un rôle extrêmement important. Evidemment elle a produit Hannibal qui a fait la guerre à Rome non pour la détruire mais - ce que le grand public ne sait pas - pour équilibrer la Méditerranée en trois zones d’influence, carthaginoise, romaine et grecque. L’accord signé entre Hannibal et Phillipes V disait : «Si Rome veut s’associer à nous, elle aura les mêmes avantages et les mêmes droits et devoirs que Carthage.» Mais Rome voulait être la seule puissance méditerranéenne. S’ensuivront donc les guerres puniques et la grande aventure d’Hannibal en Espagne, la Gaule, l’Italie puis le retour en Afrique et la mort en exil. Finalement on peut dire que Jugurtha a subi presque le même sort parce que Rome ne voulait pas de personnalités influentes. Elle les éliminerait d’une façon ou d’une autre.
Professeur, votre critique quant à un certain algéro-centrisme sur la question amazighe a surpris la salle. Des conférenciers on recadré la problématique. Avez-vous été convaincu par les réponses ?
Un colloque est fait pour débattre et parfois l’auditoire ne saisit pas tout ce qu’un intervenant veut dire. J’ai senti que la question de l’amazighité était un peu trop algéro-centriste. J’ai voulu faire comprendre que l’amazighité concerne l’ensemble de l’Afrique du Nord, de la grande Syrte en Libye jusqu’à l’Atlantique. Cela ne relève pas du politique mais de données absolument objectives ; les toponymes qu’on trouve en Libye on les retrouve en Tunisie, en Algérie, en Libye et au Maroc.
Trouvez-vous que l’on débat de ce sujet plus en Algérie qu’en Tunisie ?
Un peu moins en Tunisie tout simplement parce que nous avons l’impression que ça va de soi, que notre arabité irrigue notre amazighité, le fond berbère étant incontestable. Nous ne sommes pas des Arabes ethniquement mais de culture simplement. Nous considérons que tous les habitants de l’Afrique du Nord sont berbères, mais il y a des berbérophones et des berbères arabophones. Le socle de la population est berbère.
Vous dites, lors du débat sur la décolonisation de l’histoire coloniale, qu’il faut rendre hommage à la France qui nous a ouvert les yeux sur ce que nous sommes. Pourquoi cette déclaration qui peut prêter à confusion ?
Oui, mais il n’y a là aucune confusion, je suis conscient de ce que je dis. C’est elle qui volontairement ou pas nous a ouvert les yeux et c’est d’une grande noblesse quand quelqu’un vous donne la vue. Je me rappelle quand j’étais en France, la première fois, quelqu’un m’a dit pourquoi vous venez en France, je lui ai rétorqué : c’est pour acheter des lunettes ! Je lui signifiais que c’est pour voir une autre réalité et parce que sans l’Autre je ne suis pas. Mon ennemi d’hier peut ne pas être mon ennemi d’aujourd’hui ou de demain.
Si je vous ai bien compris, les débats ont fait ressortir que nous disposons des outils de relecture (déconstruction-reconstruction) de notre histoire ancienne et contemporaine. A contrario vous demandez si nous disposons aussi des outils pour proposer une autre alternative de construction de nos sociétés postcoloniales ?
Exactement. A mon avis la déconstruction est intellectuelle parce que le peuple en est loin. Mais le vrai travail consiste à faire en sorte que le public se sente impliqué par son patrimoine dont des villes comme Timgad, Tipasa ou Hippone. Si je parle de la Tunisie, les gens ne se sentent pas encore propriétaires de leur patrimoine. Lors de l’attaque du Bardo, les gens en ont souffert parce que c’est un haut lieu du tourisme, parce que le Bardo c’est fait pour les autres. Donc qu’avons-nous fait pour que le Tunisien moyen se sente impliqué par les trésors du Bardo ou tel autre site et que cette appropriation le féconde ? Le patrimoine est un fertilisant dont il faut profiter mais dans le meilleur des cas ça reste au niveau de l’intellect.
Quelle serait, selon vous, l’utilité de la réhabilitation de tamazight dans nos sociétés qui fonctionnent sur des langues écrites et parlées ?
Je trouve important tous ces travaux et ces efforts pour une meilleure connaissance du berbère aux plans émotif et intellectuel et qu’ils deviennent un fertilisant parmi tant d’autres. Pour moi, je dirais qu’il faut nous sentir autant Berbères que Romains car nous avons fait l’arabité et la romanité. Berbères de souche nous devons considérer l’arabité comme un acquis, ce n’est pas une arabité importée. Si vous observez l’architecture arabe dans les pays du Maghreb elle ne ressemble pas à celle du Moyen-Orient. Il faut savoir dépasser le passionnel quand on a eu la chance d’avoir plusieurs apports et s’en servir comme matériau de construction pour bâtir la modernité.
Une question très actuelle : quelles sont les chances aujourd’hui pour la Tunisie de sortir de la crise ?
Je suis optimiste parce que la Tunisie ne peut plus faire marche arrière. On peut nous ralentir dans notre élan révolutionnaire mais le départ est enclenché. La plante a pris racine même si elle mettra du temps pour donner ses fruits. La preuve nous avons aujourd’hui cette chance exceptionnelle sans laquelle il n’y a aucune possibilité de se développer, c’est la liberté d’expression et la liberté de conscience.
Le poids des islamistes aujourd’hui ?
Ecoutez l’islam restera toujours dans nos pays parce que c’est une religion qui prône les valeurs universelles qu’elle partage avec toutes les religions et la différence n’est que culturelle, par exemple dans notre façon de faire la prière différente de la prière juive ou bouddhiste.
Pour changer de registre, une question sur l’Algérie, si je peux me permettre. Qu’est-ce que vous aimez de l’Algérie et ce que vous n’aimez pas ?
J’ai beaucoup aimé dans le temps la littérature algérienne francophone. C’est un grand pays, un peuple admirable au regard de son histoire et la manière avec laquelle il a su se débarrasser de plus d’un siècle d’une colonisation terrible. Mais comme toute colonisation celle-ci n’est pas uniquement négative car elle laisse aussi beaucoup de traces positives. J’aime aussi la grandeur des personnalités qu’elle a données dans tous les domaines et ses potentialités comme puissance capable de jouer un rôle important, positif pour faire barrage à des ambitions illégitimes de l’extérieur. L’Algérie est encore en train de se faire. Ce que j’aimerais est que l’amazighité s’élargisse et reconnaisse les autres cultures. Je n’aimerais pas une amazighité qui rejetterait l’arabité étant entendu que notre arabité maghrébine, nord-africaine est spécifique. Nous ne sommes pas l’Orient mais le Maghreb.
Brahim Taouchichet Le Soir du samedi 27 août 2016