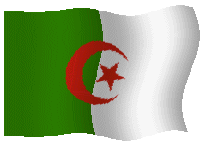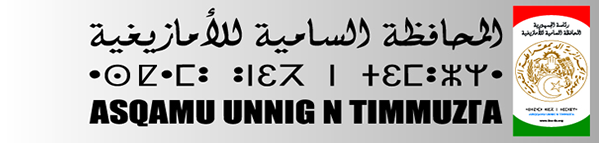Cinquante-deux ans après son assassinat par les hordes de l'OAS, ce fut le 15 mars 1962, Mouloud Feraoun est plus présent que jamais dans le Panthéon des lettres algériennes. Ses ouvrages sont régulièrement réédités et traduits, mais, malheureusement, l'école algérienne s'intéresse de moins en moins à ses textes pour les insérer dans les manuels scolaires. Cet écrivain, déclaré classique algérien, racé, humaniste, fait de plus en plus l'objet d'un intérêt particulier de la part de ceux qui travaillent sur la langue berbère. Un de ses ouvrages, Le Fils du pauvre, a ainsi été traduit par feu Moussa Ould Taleb en 2004 (éditions HCA). À l'occasion de la parution de cette traduction, nous écrivions alors : « Dans cette entreprise de réhabilitation de la langue berbère en général et du kabyle en particulier, qui mieux que l’œuvre de Mouloud Féraoun se prête à l’exercice de traduction ? Certains parlent même de travail de restitution tant le texte de Fouroulou “respire’’ partout la Kabylie mais aussi la langue kabyle. Les lecteurs kabyles du Fils du pauvre ou des chemins qui montent se retrouvent aisément, non seulement en raison des scènes et tableaux familiers auxquels ils ont affaire, mais également en raison d’une langue française au travers de laquelle défile en filigrane la langue kabyle : formules consacrées, locutions idiomatiques tirées du terroir et d’autres repères linguistiques jettent des ponts entre deux cultures à la manière de l’écrivain, lui-même situé, dans un évident déchirement, à la jonction de deux mondes, deux civilisations, dont il a voulu être le lien solidaire. Cette fidèle dualité lui a valu non seulement des inimitiés mais aussi fatalement l’irréparable verdict de l’extrémisme ayant conduit à l’assassinat de l’écrivain humaniste ». Cette appréciation a été reproduite en quatrième de couverture dans une réédition, deux ans plus tard, du même livre, par les éditions Odyssée de Tizi-Ouzou. Le mouvement de traduction vers tamazight est ainsi tracé pour de nouvelles réalisations qui devront prendre en charge l'ensemble de ses romans et, pourquoi pas, son Journal et autres études telles ’’L'Anniversaire’’. Les textes de Fouroulou, ainsi que ceux de Mouloud Mammeri, Taos Amrouche, Malek Ouary, sont censés avoir leur place dans les manuels scolaires en tamazight, à côté des poèmes d'Aït Menguellet et Matoub Lounès. Les traductions de certaines œuvres de Mouloud Feraoun en arabe ont péché par des approximations qui ont émaillé certains passages. On en est même arrivé à adopter des titres différents, selon l'auteur de la traduction, à chaque traduction du même livre. Mouloud Feraoun est né le 8 mars 1913 à Tizi Hibel, dans les Ath Douala. Son vrai nom est Aït Chabane. Il est issu d’une famille paysanne pauvre. Son père, mort en 1958, avait travaillé en France comme mineur. Mouloud a été berger pendant une année. A sept ans, il entre à l’école de Taourirt-Moussa. Par la suite, il rejoint le collège de Tizi-Ouzou grâce à une bourse. Il fait ensuite l’École Normale de Bouzaréah où il fera la connaissance de plusieurs Européens et Algériens dont certains, comme Emmanuel Roblès, deviendront de véritables amis de notre futur écrivain. Instituteur dans son village natal en 1935, puis à Taourirt-Moussa en 1946, il épousera sa cousine Dahbia avec laquelle il aura sept enfants. Au début des années 1940, il est affecté à l’école de Taboudrist à Beni Douala, avant d’exercer pendant une année à l’école d’Aït Abdelmoumène. Il travaillera comme enseignant à l’école de Taourirt-Moussa de 1946 à 1952. En 1939, il avait déjà commencé à écrire son premier roman qu’il avait appelé Fouroulou Menrad et qui deviendra par la suite Le Fils du pauvre, publié pour la première fois en 1950 dans la revue Les Cahiers du nouvel humanisme. Ce livre reçut le Prix de la ville d’Alger. En 1952, Feraoun est nommé directeur du cours complémentaire de Fort-National avant d’occuper cinq ans plus tard le poste de directeur de l’école Nador au Clos-Salembier (Alger). Il reçoit le Prix Populiste pour son deuxième roman La Terre et le sang en 1953. Il publiera Jours de Kabylie en 1954. Cet ensemble de tableaux illustrés par les dessins de Brouty est à mi-chemin entre le roman et la nouvelle avec, en plus, la suavité propre au conte. Les Chemins qui montent est publié au Seuil en 1957, un roman qui continue en quelque sorte La Terre et le sang. C’est en 1960 que paraît aux éditions de Minuit le recueil intitulé Les Poèmes de Si Mohand. Un livre inachevé est publié en 1972 sous le titre L’Anniversaire. Mouloud Feraoun a aussi écrit des chroniques et des notes pendant la guerre de Libération qui deviendront par la suite Le Journal, témoignage capital sur la guerre. Les lettres qu’il écrivait à ses amis entre 1949 et 1962 ont été publiées aux éditions du Seuil en 1969 sous le simple titre Lettres à ses amis. Les éditions Yacom ont publié en 2007 le dernier livre de Feraoun sous le titre La Cité des Roses. Ce roman a été écrit en 1958, avec des ajouts au début de l'année 1962, juste avant l'assassinat de l'auteur. Il s'agit d'une histoire sentimentale, sur un fond de déchirements charriés par la guerre de Libération nationale.
Comme si une giclée de balles…
Mouloud Mammeri, dans la préface au roman La Terre et le sang de Feraoun, réédité par les éditions ENAG en 1988, écrivait : « Mouloud, cela me fait drôle de parler de toi comme si tu étais mort… comme si une giclée de balles imbéciles pouvait t’avoir arraché de notre vie, sous prétexte qu’elles t’avaient un matin de mars 1962 stupidement rayé du paysage…C’était le dernier hommage de la bêtise à la vertu. Mais, vieux frère, tu en as connu d’autres ; tu sais, toi, que pour aller à Ighil Nezmen, de quelque côté qu’on les prenne, les chemins montent. Et puis après ? Tu sais aussi que les hauteurs se méritent. En haut des collines de Adrar n nnif on est plus près du ciel. Du paysage, ce sont ceux qui ont craché leur rage en douze balles, six secondes, qui ont disparu, rayés, parce qu’ils n’avaient pas assez de sang généreux dans les veines, assez de rêves fous dans les yeux, pour y demeurer (…) En parlant de nous, ils disaient ‘’les Arabes’’ et…dans la moue de leurs lèvres ce n’était pas une désignation, c’était un verdict ! Mais nous, Mouloud, nous savons que ce ne pouvait pas être autrement : ils avaient tout cela, mais il leur manquait l’essentiel : LA TERRE ET LE SANG ! ».
Amar Naït Messaoud